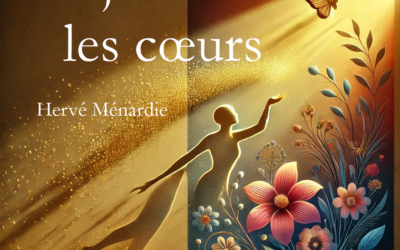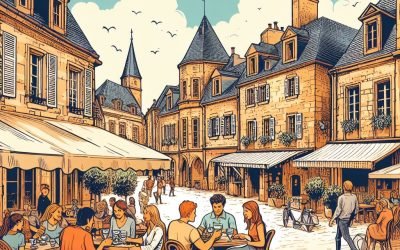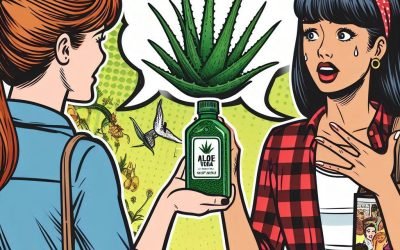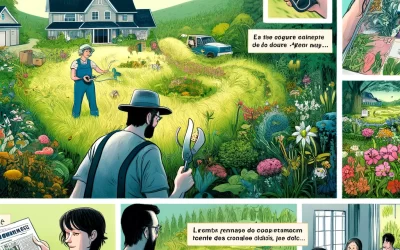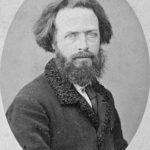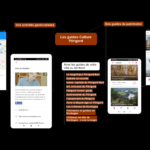Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
Communiqué de presse
Déclin dangereux de la Nature:
taux d’accélération ‘ sans précédent’ des espèces ‘en accélération’
Réponse globale actuelle insuffisante;
Les «changements transformateurs» nécessaires pour restaurer et protéger la nature;
L’opposition d’intérêts personnels peut être vaincue pour le bien public
Évaluation la plus complète du genre;
1.000.000 d’espèces menacées d’extinction
La nature recule globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité – et le taux d’extinction d’espèces s’accélère, entraînant de graves conséquences pour les populations du monde entier, met en garde un nouveau rapport historique de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ( IPBES) ), dont le résumé a été approuvé lors de la 7e session de la plénière de l’IPBES, réunie la semaine dernière à Paris (du 29 avril au 4 mai).
«Les preuves accablantes de l’évaluation globale de l’IPBES, issues d’un large éventail de domaines de connaissances, donnent une image inquiétante», a déclaré Sir Robert Watson, président de l’IPBES. «La santé des écosystèmes dont nous et toutes les autres espèces dépendons se détériore plus rapidement que jamais. Nous érodons les fondements mêmes de nos économies, de nos moyens de subsistance, de la sécurité alimentaire, de la santé et de la qualité de la vie dans le monde. ”
« Le rapport nous indique également qu’il n’est pas trop tard pour faire la différence, mais seulement si nous commençons maintenant à tous les niveaux, du local au global », a-t-il déclaré. «Grâce au« changement de transformation », la nature peut toujours être conservée, restaurée et utilisée de manière durable – c’est également essentiel pour atteindre la plupart des autres objectifs mondiaux. Par changement transformateur, nous entendons une réorganisation fondamentale à l’échelle du système, qui englobe des facteurs technologiques, économiques et sociaux, notamment des paradigmes, des objectifs et des valeurs. ”
«Les États membres de la plénière de l’IPBES ont maintenant reconnu que, de par leur nature même, un changement transformateur peut susciter une opposition de la part des personnes ayant des intérêts dans le statu quo, mais aussi qu’une telle opposition peut être surmontée pour le bien public plus large», a déclaré Watson.
Le rapport d’évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques de l’IPBES est le plus complet jamais réalisé. Il s’agit du premier rapport intergouvernemental en son genre. Il s’appuie sur l’évaluation historique des écosystèmes pour le millénaire, réalisée en 2005, et propose des méthodes novatrices d’évaluation des preuves.
Compilé par 145 auteurs experts de 50 pays au cours des trois dernières années, avec la contribution de 310 autres auteurs, le rapport évalue les changements survenus au cours des cinq dernières décennies et fournit une image complète de la relation entre les trajectoires de développement économique et leurs impacts sur la nature. Il propose également une gamme de scénarios possibles pour les décennies à venir.
Basé sur l’examen systématique d’environ 15 000 sources scientifiques et gouvernementales, le rapport s’appuie également (pour la première fois à cette échelle) sur les connaissances autochtones et locales, en particulier sur des questions relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales.
«La biodiversité et les contributions de la nature à la population constituent notre patrimoine commun et le plus important« filet de sécurité »de l’humanité. Mais notre filet de sécurité est presque épuisé », a déclaré la professeure Sandra Díaz (Argentine), qui a coprésidé l’évaluation avec les professeurs Josef Settele (Allemagne) et Eduardo S. Brondízio (Brésil et États-Unis). «La diversité au sein des espèces, entre les espèces et des écosystèmes, ainsi que de nombreuses contributions fondamentales que nous tirons de la nature, décline rapidement, bien que nous ayons encore les moyens d’assurer un avenir durable aux hommes et à la planète.»
Le rapport constate qu’environ un million d’espèces animales et végétales sont maintenant menacées de disparition, dont beaucoup en quelques décennies, plus que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité.
L’abondance moyenne des espèces indigènes dans la plupart des principaux habitats terrestres a diminué d’au moins 20%, principalement depuis 1900. Plus de 40% des espèces d’amphibiens, près de 33% des coraux en reconstitution et plus du tiers de tous les mammifères marins sont menacés . La situation est moins claire pour les espèces d’insectes, mais les données disponibles confirment une estimation provisoire de 10% des menaces. Au moins 680 espèces de vertébrés avaient disparu depuis le XVIe siècle et plus de 9% de toutes les races de mammifères domestiquées utilisées pour l’alimentation et l’agriculture avaient disparu en 2016, et au moins 1 000 autres races étaient toujours menacées.
«Les écosystèmes, les espèces, les populations sauvages, les variétés locales et les races de plantes et d’animaux domestiqués sont en train de se rétrécir, de se détériorer ou de disparaître. Le réseau essentiel et interconnecté de la vie sur Terre est de plus en plus petit et de plus en plus effiloché », a déclaré le professeur Settele. « Cette perte est le résultat direct de l’activité humaine et constitue une menace directe pour le bien-être humain dans toutes les régions du monde. »
Pour accroître la pertinence politique du rapport, les auteurs de l’évaluation ont classé, pour la première fois à cette échelle et sur la base d’une analyse approfondie des preuves disponibles, les cinq facteurs directs de changement de la nature ayant le plus grand impact global relatif jusqu’à présent. . Ces coupables sont, par ordre décroissant: (1) des modifications de l’utilisation des terres et des mers; (2) exploitation directe d’organismes; (3) le changement climatique; (4) pollution et (5) espèces exotiques envahissantes.
Le rapport note que, depuis 1980, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé, augmentant les températures moyennes mondiales d’au moins 0,7 degrés Celsius – le changement climatique ayant déjà un impact sur la nature, du niveau des écosystèmes à celui de la génétique – les impacts devraient augmenter au cours des prochaines décennies, dans certains cas, l’impact des changements d’utilisation de la terre et de la mer et d’autres facteurs est dépassé.
Malgré les progrès réalisés en matière de conservation de la nature et de mise en œuvre des politiques, le rapport constate également que les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs mondiaux de conservation et d’utilisation durable de la nature et d’atteindre la durabilité, et que les objectifs pour 2030 et au-delà ne peuvent être atteints que par des changements en profondeur aux niveaux économique, social, social et social. facteurs politiques et technologiques. Avec de bons progrès sur les composants de seulement quatre des 20 objectifs d’Aichi relatifs à la biodiversité, il est probable que la plupart d’entre eux ne seront pas atteints à la date limite de 2020. Les tendances négatives actuelles en matière de biodiversité et d’écosystèmes entraveront les progrès accomplis dans la réalisation de 80% (35 sur 44) des objectifs fixés pour la réalisation des objectifs de développement durable, en ce qui concerne la pauvreté, la faim, la santé, l’eau, les villes, le climat, les océans et les terres (ODD 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 et 15). La perte de biodiversité s’avère donc non seulement comme un problème environnemental,
«Pour mieux comprendre et, plus important encore, s’attaquer aux principales causes des dommages causés à la biodiversité et à la contribution de la nature à l’homme, nous devons comprendre l’histoire et l’interconnexion mondiale de facteurs de changement démographiques et économiques complexes, ainsi que les valeurs sociales les soutenir », a déclaré le professeur Brondízio. «Les principaux facteurs indirects comprennent l’augmentation de la population et la consommation par habitant; l’innovation technologique, qui dans certains cas a réduit et dans d’autres cas augmenté les dommages causés à la nature; et, de manière critique, les questions de gouvernance et de responsabilité. Une tendance se dessine est celle de l’interconnectivité mondiale et du « télécouplage », l’extraction et la production des ressources ayant souvent lieu dans une partie du monde pour satisfaire les besoins des consommateurs lointains d’autres régions. «
Parmi les autres conclusions notables du rapport, notons [1] :
- Les trois quarts de l’environnement terrestre et environ 66% de l’environnement marin ont été considérablement altérés par les activités humaines. En moyenne, ces tendances ont été moins graves ou moins évitées dans les zones détenues ou gérées par les peuples autochtones et les communautés locales.
- Plus du tiers de la surface terrestre mondiale et près de 75% des ressources en eau douce sont maintenant consacrés à la production végétale ou animale.
- La valeur de la production agricole a augmenté d’environ 300% depuis 1970, la récolte de bois brut a augmenté de 45% et environ 60 milliards de tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables sont désormais extraites chaque année dans le monde – après avoir presque doublé depuis 1980.
- La dégradation des sols a réduit la productivité de 23% de la surface terrestre mondiale. Les pertes de pollinisateurs risquent de faire perdre jusqu’à 577 milliards de dollars de cultures mondiales et 100 à 300 millions de personnes sont exposées à un risque accru d’inondations et d’ouragans en raison de la perte d’habitats côtiers. et protection.
- En 2015, 33% des stocks de poissons marins étaient exploités à des niveaux insoutenables; 60% ont été pêchés au maximum de manière durable, 7% seulement étant capturés à des niveaux inférieurs à ceux pouvant être pêchés de manière durable.
- Les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992.
- La pollution par les matières plastiques a été multipliée par dix depuis 1980. 300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets provenant d’installations industrielles sont déversées chaque année dans les eaux de la planète et les engrais pénétrant dans les écosystèmes côtiers ont produit plus de 400 zones mortes dans les océans. , totalisant plus de 245 000 km2 (591-595) – une superficie combinée supérieure à celle du Royaume-Uni.
- Les tendances négatives dans la nature se poursuivront jusqu’en 2050 et au-delà dans tous les scénarios politiques explorés dans le rapport, à l’exception de ceux qui incluent un changement en profondeur – en raison des impacts prévus de la modification croissante de l’affectation des sols, de l’exploitation d’organismes et du changement climatique, même différences entre les régions.
Le rapport présente également un large éventail d’actions illustrant la durabilité et les moyens de les réaliser dans différents secteurs tels que l’agriculture, la foresterie, les systèmes marins, les systèmes d’eau douce, les zones urbaines, l’énergie, la finance et bien d’autres. Il souligne qu’il est important, entre autres, d’adopter une gestion intégrée et des approches intersectorielles tenant compte des compromis entre la production alimentaire et énergétique, les infrastructures, la gestion des eaux douces et des côtes et la conservation de la biodiversité.
L’évolution des systèmes financiers et économiques mondiaux en vue de créer une économie mondiale durable est également identifiée comme un élément clé des politiques futures plus durables.
« L’IPBES présente les décideurs scientifiques, les connaissances et les options stratégiques qui font autorité », a déclaré la Secrétaire exécutive de l’IPBES, Anne Larigauderie. «Nous remercions les centaines d’experts du monde entier qui ont consacré de leur temps et de leurs connaissances pour aider à lutter contre la perte d’espèces, d’écosystèmes et de diversité génétique – une menace véritablement mondiale et générationnelle pour le bien-être humain.
– PREND FIN –
[1] Plus de détails sur un large éventail d’autres conclusions sont inclus dans la section «Informations complémentaires» du présent communiqué ci-dessous.
Notes aux rédacteurs:
Pour les demandes de renseignements et les entretiens, veuillez contacter:
L’équipe média de l’IPBES
media@ipbes.net
www.ipbes.net
Pour les interviews: français : +33 62520-0281 anglais : + 1-416-878-8712 ou + 1-415-290-5516 ou + 49-176-2538 -2223 (après le 7 mai: + 49-152-3830-0667)
L’IPBES a publié le résumé pour les décideurs du rapport d’évaluation globale. Le GPS présente les principaux messages et les principales options politiques approuvés par la plénière de l’IPBES. Pour accéder à la MPS, aux photos, au « B-roll » et à d’autres ressources multimédias, accédez à l’ adresse : bit.ly/IPBESReport . Le rapport complet en six chapitres (comprenant toutes les données) devrait dépasser 1 500 pages et sera publié plus tard cette année.
Ressources supplémentaires:
Par souci de commodité, un certain nombre de points mis en évidence dans le rapport sont résumés dans la section «Informations complémentaires» ci-après, en particulier sur:
Commentaires des partenaires de l’IPBES sur l’importance du rapport:
- Joyce Msuya, Chef par intérim, ONU-Environnement
- Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO
- José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
- Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le développement
- Cristiana Paşca Palmer, Secrétaire exécutive, Convention sur la diversité biologique
À propos de l’IPBES:
Souvent décrit comme le «GIEC pour la biodiversité», l’IPBES est un organe intergouvernemental indépendant composé de plus de 130 gouvernements membres. Créé par les gouvernements en 2012, il fournit aux décideurs politiques des évaluations scientifiques objectives sur l’état des connaissances sur la biodiversité, les écosystèmes et la contribution qu’ils apportent à la population, ainsi que sur les outils et méthodes pour protéger et utiliser durablement ces actifs naturels vitaux. Pour plus d’informations sur l’IPBES et ses évaluations, visitez www.ipbes.net
Introduction vidéo à l’IPBES : www.youtube.com/watch?v=oOiGio7YU-M
Vidéos supplémentaires:
Suivez l’IPBES sur les réseaux sociaux:
twitter.com/@ipbes
linkedin.com/company/ipbes
youtube.com/ipbeschannel
facebook.com/ipbes
instagram.com/ipbes_
Informations complémentaires sur les points clés du rapport
Échelle de perte de la nature
Les gains découlant des réactions de la société et des pouvoirs publics, bien qu’importants, n’ont pas empêché des pertes massives.
Depuis 1970, les tendances de la production agricole, de la pêche, de la production de bioénergie et de la récolte de matériaux ont augmenté. Face à la croissance démographique, à la demande croissante et au développement technologique, le prix à payer est élevé, inégalement réparti dans et entre les pays. Cependant, de nombreux autres indicateurs clés concernant les contributions de la nature à l’homme, tels que le carbone organique du sol et la diversité des pollinisateurs, ont diminué, ce qui indique que les gains en contributions matérielles ne sont souvent pas durables.
Le rythme d’expansion de l’agriculture dans des écosystèmes intacts a varié d’un pays à l’autre. Les pertes d’écosystèmes intacts se sont produites principalement dans les tropiques, qui abritent les niveaux de biodiversité les plus élevés de la planète. Ainsi, entre 1980 et 2000, 100 millions d’hectares de forêts tropicales ont été détruits, principalement en raison de l’élevage de bovins en Amérique latine (environ 42 millions d’hectares) et de plantations en Asie du Sud-Est (environ 7,5 millions d’hectares, dont 80% pour des palmiers). huile, principalement utilisée dans les aliments, les cosmétiques, les produits de nettoyage et les carburants), entre autres.
Depuis 1970, la population humaine mondiale a plus que doublé (passant de 3,7 à 7,6 milliards), augmentant de manière inégale selon les pays et les régions. et le produit intérieur brut par habitant est quatre fois plus élevé – les consommateurs de plus en plus distants déplaçant le fardeau environnemental de la consommation et de la production d’une région à l’autre.
L’abondance moyenne des espèces indigènes dans la plupart des principaux habitats terrestres a diminué d’au moins 20%, principalement depuis 1900.
Le nombre d’espèces exotiques envahissantes par pays a augmenté d’environ 70% depuis 1970, dans les 21 pays qui enregistrent des données détaillées.
Les distributions de près de la moitié (47%) des mammifères terrestres sans vol, par exemple, et de près du quart des oiseaux menacés, ont peut-être déjà été négativement affectées par le changement climatique.
Peuples autochtones, communautés locales et nature
Au moins un quart de la superficie terrestre mondiale est traditionnellement détenu, géré, utilisé ou occupé par les peuples autochtones. Ces zones comprennent environ 35% de la zone officiellement protégée et environ 35% de toutes les zones terrestres restantes où l’intervention de l’homme est très faible.
La nature gérée par les peuples autochtones et les communautés locales est soumise à une pression croissante mais son déclin est généralement moins rapide que sur d’autres pays – bien que 72% des indicateurs locaux développés et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent la détérioration de la nature qui sous-tend les moyens d’existence locaux.
Les régions du monde censées subir les effets négatifs importants des changements mondiaux du climat, de la biodiversité, des fonctions des écosystèmes et de la contribution de la nature à la population sont également des zones dans lesquelles résident de grandes concentrations de peuples autochtones et de nombreuses communautés parmi les plus pauvres du monde.
Les scénarios régionaux et mondiaux manquent actuellement et bénéficieraient d’un examen explicite des points de vue, perspectives et droits des peuples autochtones et des communautés locales, de leur connaissance et de leur compréhension des vastes régions et des écosystèmes, ainsi que de leurs voies de développement futures souhaitées. La reconnaissance des connaissances, des innovations et des pratiques, des institutions et des valeurs des peuples autochtones et des communautés locales et leur inclusion et leur participation dans la gouvernance environnementale améliorent souvent leur qualité de vie, ainsi que la conservation, la restauration et l’utilisation durable de la nature. Leurs contributions positives à la durabilité peuvent être facilitées par la reconnaissance nationale du régime foncier, des droits d’accès et des ressources conformément à la législation nationale, par l’application du consentement libre, préalable et éclairé et par une collaboration améliorée,
Objectifs globaux et scénarios de politique
Les déclins rapides passés et actuels de la biodiversité, des fonctions des écosystèmes et de nombreuses contributions de la nature à la population signifient que la plupart des objectifs sociaux et environnementaux internationaux, tels que ceux énoncés dans les objectifs d’Aichi pour la biodiversité et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ne seront pas atteints sur la base des trajectoires actuelles .
Les auteurs du rapport ont examiné six scénarios politiques – des « paniers » très différents d’options et d’approches politiques regroupées, notamment « Concurrence régionale », « Business as Usual » et « Global Sustainability » – projetant les impacts probables sur la biodiversité et les contributions de la nature à l’homme. d’ici 2050. Ils ont conclu que, sauf dans les scénarios qui incluent un changement transformateur, les tendances négatives de la nature, des fonctions de l’écosystème et de nombreuses contributions de la nature à la population se poursuivront jusqu’en 2050 et au-delà, en raison des effets projetés de l’augmentation des ressources terrestres et marines. utiliser le changement, l’exploitation des organismes et le changement climatique.
Outils politiques, options et pratiques exemplaires
Les actions politiques et les initiatives sociétales contribuent à sensibiliser l’opinion publique à l’impact de la consommation sur la nature, à la protection de l’environnement local, à la promotion d’économies locales durables et à la restauration des zones dégradées. Associés à des initiatives à différents niveaux, ils ont contribué à élargir et à renforcer le réseau actuel de réseaux d’aires protégées écologiquement représentatifs et bien connectés, ainsi que d’autres mesures de conservation efficaces, la protection des bassins versants et des mesures incitatives et sanctions visant à réduire la pollution.
Le rapport présente une liste illustrative d’actions et de voies possibles pour les réaliser, quels que soient l’emplacement, les systèmes et les échelles, susceptibles de favoriser la durabilité. Adopter une approche intégrée:
En agriculture, le rapport souligne notamment: la promotion de bonnes pratiques agricoles et agroécologiques; la planification paysagère multifonctionnelle (qui assure à la fois la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, le maintien des espèces et des fonctions écologiques) et la gestion intégrée intersectorielle. Il souligne également l’importance d’un engagement plus profond de tous les acteurs du système alimentaire (y compris les producteurs, le secteur public, la société civile et les consommateurs) et d’une gestion plus intégrée des paysages et des bassins versants; conservation de la diversité des gènes, des variétés, des cultivars, des races, des races locales et des espèces; ainsi que des approches qui responsabilisent les consommateurs et les producteurs grâce à la transparence du marché, à l’amélioration de la distribution et de la localisation (qui revitalisent les économies locales), à la réforme des chaînes d’approvisionnement et à la réduction du gaspillage alimentaire.
Dans les systèmes marins , le rapport souligne, entre autres: les approches de la gestion des pêches fondées sur les écosystèmes; planification spatiale; quotas effectifs; zones marines protégées; protéger et gérer les zones clés de la biodiversité marine; réduire la pollution par ruissellement dans les océans et travailler en étroite collaboration avec les producteurs et les consommateurs.
Dans les systèmes d’eau douce , les options et actions politiques incluent notamment: une gouvernance de l’eau plus inclusive pour une gestion collaborative de l’eau et une plus grande équité; une meilleure intégration de la gestion des ressources en eau et de la planification du paysage à toutes les échelles; promouvoir des pratiques visant à réduire l’érosion des sols, la sédimentation et le ruissellement de la pollution; augmentation du stockage de l’eau; promouvoir les investissements dans les projets liés à l’eau avec des critères de durabilité clairs; et s’attaquer à la fragmentation de nombreuses politiques relatives à l’eau douce.
Dans les zones urbaines , le rapport souligne, entre autres: la promotion de solutions basées sur la nature; accroître l’accès aux services urbains et à un environnement urbain sain pour les communautés à faible revenu; améliorer l’accès aux espaces verts; production et consommation durables et connectivité écologique dans les espaces urbains, en particulier avec les espèces indigènes.
Parmi tous les exemples, le rapport reconnaît l’importance d’inclure différents systèmes de valeurs et divers intérêts et visions du monde dans la formulation des politiques et des actions. Cela inclut la participation pleine et entière des peuples autochtones et des communautés locales à la gouvernance, la réforme et la mise en place de structures d’incitation et la nécessité de donner la priorité aux considérations relatives à la diversité biologique dans tous les secteurs clés de la planification.
«Nous avons déjà assisté aux premières manifestations d’actions et d’initiatives pour un changement en profondeur, telles que les politiques novatrices de nombreux pays, autorités locales et entreprises, mais plus particulièrement des jeunes du monde entier», a déclaré Sir Robert Watson. «Des jeunes leaders mondiaux du mouvement #VoiceforthePlanet aux grèves dans les écoles, il y a une profonde conviction que des mesures urgentes s’imposent si nous voulons garantir quelque chose qui approche d’un avenir durable. Le rapport d’évaluation globale de l’IPBES offre les meilleures données d’experts disponibles pour éclairer ces décisions, politiques et actions – et fournit la base scientifique du cadre de la biodiversité et des nouveaux objectifs décennaux pour la biodiversité, qui sera décidée à la fin de 2020 en Chine, sous les auspices du la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. «
En chiffres – Statistiques clés et faits du rapport
Général
- 75%: l’environnement terrestre a été «gravement altéré» à ce jour par les actions humaines (environnements marins 66%)
- 47%: réduction des indicateurs mondiaux de l’étendue et de la condition des écosystèmes par rapport à leurs niveaux de base naturels estimés, nombre d’entre eux continuant de diminuer d’au moins 4% par décennie
- 28%: superficie totale des terres détenues et / ou gérées par les peuples autochtones, y compris> 40% des aires officiellement protégées et 37% de toutes les zones terrestres restantes avec une très faible intervention humaine
- +/- 60 milliards: tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables extraites chaque année dans le monde, soit une augmentation de près de 100% depuis 1980
- 15%: augmentation de la consommation mondiale de matériaux par habitant depuis 1980
- > 85%: des zones humides présentes en 1700 avaient été perdues en 2000 – la perte de zones humides est actuellement trois fois plus rapide, en termes de pourcentage, que la perte de forêts.
Espèces, populations et variétés de plantes et d’animaux
- 8 millions: nombre total estimé d’espèces animales et végétales sur Terre (y compris 5,5 millions d’espèces d’insectes)
- Des dizaines à des centaines de fois: le taux actuel d’extinction globale des espèces est supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d’années, et ce taux s’accélère
- Jusqu’à 1 million: espèces menacées de disparition, dont beaucoup en quelques décennies
- > 500 000 (+/- 9%): part de la population mondiale estimée à 5,9 millions d’espèces terrestres avec un habitat insuffisant pour leur survie à long terme sans restauration de l’habitat
- > 40%: espèces d’amphibiens menacées d’extinction
- Près de 33%: coraux formant des récifs, requins et parents de requins, et> 33% de mammifères marins menacés d’extinction
- 25%: proportion moyenne d’espèces menacées d’extinction parmi les groupes de vertébrés, d’invertébrés et de plantes terrestres, d’eau douce et marins qui ont été étudiés de manière suffisamment détaillée
- Au moins 680: des espèces de vertébrés menacées d’extinction par l’action de l’homme depuis le 16ème siècle
- +/- 10%: estimation provisoire de la proportion d’espèces d’insectes menacées d’extinction
- > 20%: déclin de l’abondance moyenne des espèces indigènes dans la plupart des principaux biomes terrestres, principalement depuis 1900
± 560 (+/- 10%): les races de mammifères domestiquées étaient éteintes en 2016, avec au moins 1 000 de plus menacées
- 3,5%: race domestique d’oiseaux éteinte d’ici 2016
- 70%: augmentation depuis 1970 du nombre d’espèces exotiques envahissantes dans 21 pays avec enregistrements détaillés
- 30%: réduction de l’intégrité de l’habitat terrestre mondial causée par la perte et la détérioration de l’habitat
- 47%: proportion de mammifères terrestres incapables de voler et 23% d’oiseaux menacés dont la répartition aurait déjà été affectée par le changement climatique
- > 6: les espèces d’ongulés (mammifères à sabots) seraient probablement éteintes ou ne survivraient qu’en captivité aujourd’hui sans mesures de conservation
Alimentation et agriculture
- 300%: augmentation de la production vivrière depuis 1970
- 23%: zones terrestres ayant connu une réduction de la productivité due à la dégradation des sols
- > 75%: types de cultures vivrières mondiales qui dépendent de la pollinisation des animaux
- 235 à 577 milliards USD: valeur annuelle de la production mondiale de cultures menacée par la perte de pollinisateurs
- 5,6 gigatonnes: émissions annuelles de CO2 séquestrées dans les écosystèmes marins et terrestres – équivalant à 60% des émissions mondiales de combustibles fossiles
- +/- 11%: population mondiale sous-alimentée
- 100 millions d’hectares d’expansion agricole sous les tropiques de 1980 à 2000, principalement des fermes d’élevage en Amérique latine (+/- 42 millions d’ha) et des plantations en Asie du Sud-Est (+/- 7,5 millions d’ha, dont 80% sont des palmiers à huile) ), la moitié au détriment des forêts intactes
- 3%: augmentation de la transformation des terres en agriculture entre 1992 et 2015, principalement au détriment des forêts
- > 33%: la surface terrestre mondiale (et +/- 75% des ressources en eau douce) consacrée à la production végétale ou animale
- 12%: terres mondiales libres de glace utilisées pour la production de cultures
- 25%: terres libres de glace du monde utilisées pour le pâturage (+/- 70% des terres arides)
- +/- 25%: émissions de gaz à effet de serre causées par le défrichage, la production agricole et la fertilisation, les aliments d’origine animale contribuant pour 75% à ce chiffre
- +/- 30%: production végétale mondiale et approvisionnement alimentaire mondial assurés par de petites exploitations (moins de 2 ha), utilisant +/- 25% des terres agricoles, conservant généralement une riche biodiversité agricole.
- 100 milliards de dollars: niveau estimé de l’aide financière dans les pays de l’OCDE (2015) à une agriculture potentiellement dommageable pour l’environnement
Océans et pêche
- 33%: les stocks de poissons de mer en 2015 sont exploités à des niveaux insoutenables; 60% sont pêchés au maximum de manière durable; 7% sont sous-exploités
- > 55%: zone océanique couverte par la pêche industrielle
- 3-10%: diminution prévue de la production primaire nette des océans due au seul changement climatique d’ici la fin du siècle
- 3-25%: diminution prévue de la biomasse de poisson d’ici la fin du siècle selon les scénarios de réchauffement climatique faible et élevé
- > 90%: proportion des pêcheurs commerciaux mondiaux correspondant à la pêche artisanale (plus de 30 millions de personnes) – représentant près de 50% des prises de poisson mondiales
- Jusqu’à 33%: part estimée en 2011 des captures de poisson déclarées dans le monde qui sont illégales, non déclarées ou non réglementées
- > 10%: diminution par décennie de l’étendue des herbiers marins de 1970 à 2000
- +/- 50%: couverture corallienne vivante de récifs perdus depuis 1870
- 100-300 millions: les habitants des zones côtières sont exposés à un risque accru en raison de la perte de protection de l’habitat côtier
- 400: zones mortes de l’écosystème côtier à faible teneur en oxygène (hypoxique) causées par des engrais, affectant plus de 245 000 km2
- 29%: réduction moyenne du risque d’extinction pour les mammifères et les oiseaux dans 109 pays grâce aux investissements en faveur de la conservation réalisés de 1996 à 2008; le risque d’extinction d’oiseaux, de mammifères et d’amphibiens aurait été d’au moins 20% plus grand sans une action de conservation au cours de la dernière décennie
- > 107: oiseaux, mammifères et reptiles extrêmement menacés auraient bénéficié de l’éradication des mammifères envahissants dans les îles
Les forêts
- 45%: augmentation de la production de bois brut depuis 1970 (4 milliards de mètres cubes en 2017)
- +/- 13 millions: emplois dans l’industrie forestière
- 50%: expansion agricole au détriment des forêts
- 50%: diminution du taux net de perte de forêts depuis les années 1990 (à l’exclusion de celles gérées pour le bois ou l’extraction agricole)
- 68%: superficie forestière mondiale aujourd’hui comparée au niveau préindustriel estimé
- 7%: réduction des forêts intactes (> 500 km 2 sans pression humaine) de 2000 à 2013 dans les pays développés et en développement
- 290 millions d’hectares (+/- 6%): couvert forestier indigène perdu de 1990 à 2015 en raison du défrichement et de la récolte du bois
- 110 millions d’hectares: augmentation de la superficie des forêts plantées de 1990 à 2015
- 10-15%: approvisionnement mondial en bois fourni par la foresterie illégale (jusqu’à 50% dans certaines régions)
- > 2 milliards de personnes qui dépendent du bois de chauffage pour satisfaire leurs besoins en énergie primaire
Mines et Energie
- <1%: terres totales utilisées pour l’exploitation minière, mais l’industrie a des impacts négatifs importants sur la biodiversité, les émissions, la qualité de l’eau et la santé humaine
- +/- 17 000: sites miniers à grande échelle (dans 171 pays), gérés pour la plupart par 616 sociétés internationales
- +/- 6 500: installations minières océaniques de pétrole et de gaz en mer ((dans 53 pays)
- 345 milliards USD: subventions mondiales aux combustibles fossiles entraînant des coûts totaux de 5 000 milliards USD, y compris les externalités liés à la dégradation de la nature; le charbon compte pour 52% des subventions après impôt, le pétrole pour +/- 33% et le gaz naturel pour +/- 10%
Urbanisation, développement et enjeux socioéconomiques
- > 100%: croissance des zones urbaines depuis 1992
- 25 millions de km: longueur des nouvelles routes revêtues prévue d’ici 2050, dont 90% de construction dans les pays les moins avancés et les pays en développement
- +/- 50 000: nombre de grands barrages (> 15 m de hauteur); +/- 17 millions de réservoirs (> 0,01 ha)
- 105%: augmentation de la population humaine mondiale (de 3,7 à 7,6 milliards) depuis 1970 de manière inégale selon les pays et les régions
- 50 fois plus élevé: PIB par habitant dans les pays développés par rapport aux pays les moins avancés
- > 2 500: conflits autour des combustibles fossiles, de l’eau, de la nourriture et des terres qui se produisent actuellement dans le monde entier
- > 1 000: militants et journalistes écologistes tués entre 2002 et 2013
Santé
- 70%: proportion de médicaments anticancéreux naturels ou synthétiques inspirés de la nature
- +/- 4 milliards: personnes qui dépendent principalement de médicaments naturels
- 17%: maladies infectieuses transmises par des vecteurs animaux, causant plus de 700 000 décès par an
- +/- 821 millions: l’insécurité alimentaire en Asie et en Afrique
- 40%: la population mondiale n’a pas accès à une eau potable propre et salubre
- > 80%: eaux usées mondiales rejetées dans l’environnement sans traitement
- 300-400 millions de tonnes: métaux lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets provenant d’installations industrielles déversées chaque année dans les eaux du monde
- 10 fois: augmentation de la pollution plastique depuis 1980
Changement climatique
- 1 degré Celsius: différence de température mondiale moyenne en 2017 par rapport aux niveaux préindustriels, en hausse de +/- 0,2 (+/- 0,1) degré Celsius par décennie
- > 3 mm: élévation moyenne annuelle du niveau de la mer au cours des deux dernières décennies
- 16-21 cm: élévation du niveau moyen mondial de la mer depuis 1900
- Augmentation de 100% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1980, élevant la température mondiale moyenne d’au moins 0,7 degré
- 40%: augmentation de l’empreinte carbone du tourisme (jusqu’à 4,5 Gt de dioxyde de carbone) de 2009 à 2013
- 8% des émissions totales de gaz à effet de serre proviennent des transports et de la consommation alimentaire liée au tourisme
- 5%: fraction estimée des espèces en risque de disparition allant du réchauffement à la température de 2 ° C seule à 16% à 4,3 ° C
- Même pour un réchauffement planétaire de 1,5 à 2 degrés, la majorité des aires de répartition des espèces terrestres devrait se contracter profondément.
Objectifs globaux
- Les plus: les objectifs d’Aichi pour la biodiversité à l’horizon 2020 risquent d’être manqués
- 22 sur 44: les cibles évaluées au titre des objectifs de développement durable relatives à la pauvreté, la faim, la santé, l’eau, les villes, le climat, les océans et la terre sont sapées par les tendances négatives substantielles de la nature et ses contributions à la population
- 72%: des indicateurs locaux dans la nature développés et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales qui montrent des tendances négatives
- 4: nombre d’objectifs d’Aichi pour lesquels des progrès ont été réalisés sur certaines composantes, avec des progrès modérés sur certains composants de 7 autres objectifs, des progrès médiocres sur tous les composants de 6 objectifs et des informations insuffisantes pour évaluer les progrès sur tout ou partie des composants restants 3 cibles
__________________
Commentaires des partenaires IPBES
«La nature rend le développement humain possible, mais notre demande incessante de ressources de la planète accélère les taux d’extinction et dévaste les écosystèmes de la planète. ONU Environnement est fier d’appuyer le rapport d’évaluation global produit par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, car il souligne la nécessité cruciale d’intégrer les considérations relatives à la biodiversité dans les processus décisionnels mondiaux relatifs à tout secteur ou défi, que ce soit l’eau ou l’agriculture, infrastructure ou entreprise. «
– Joyce Msuya, Chef par intérim, ONU-Environnement
«À travers les cultures, les êtres humains attachent de la valeur à la nature. La magie de voir des lucioles qui scintillent dans la nuit est immense. Nous puisons l’énergie et les nutriments dans la nature. Nous trouvons des sources d’aliments, de médicaments, de moyens de subsistance et d’innovation dans la nature. Notre bien-être dépend fondamentalement de la nature. Nos efforts pour conserver la biodiversité et les écosystèmes doivent s’appuyer sur les meilleures données scientifiques que l’humanité puisse produire. C’est pourquoi les preuves scientifiques rassemblées dans cette évaluation globale de l’IPBES sont si importantes. Cela nous aidera à construire une base plus solide pour façonner le cadre mondial pour la biodiversité après 2020: le «New Deal for Nature and People»; et pour atteindre les ODD. ”
– Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le développement
«Ce rapport essentiel rappelle à chacun de nous la vérité évidente: les générations actuelles ont la responsabilité de léguer aux générations futures une planète qui ne soit pas endommagée de façon irréversible par l’activité humaine. Nos connaissances locales, autochtones et scientifiques prouvent que nous avons des solutions et donc plus d’excuses: nous devons vivre sur terre différemment. L’UNESCO s’est engagée à promouvoir le respect du vivant et de sa diversité, la solidarité écologique avec d’autres espèces vivantes et à établir de nouveaux liens équitables et mondiaux de partenariat et de solidarité intragénérationnelle, pour la perpétuation de l’humanité. «
– Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO
«Le rapport d’évaluation mondial 2019 de l’IPBES sur la biodiversité et les services écosystémiques arrive à un moment critique pour la planète et tous ses peuples. Les conclusions du rapport – et les années de travail assidu des nombreux scientifiques qui ont contribué – fourniront une vue d’ensemble des conditions actuelles de la biodiversité dans le monde. Une biodiversité saine est l’infrastructure essentielle qui soutient toutes les formes de vie sur Terre, y compris la vie humaine. Il fournit également des solutions naturelles aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux les plus critiques auxquels nous sommes confrontés en tant que société humaine, notamment le changement climatique, le développement durable, la santé, la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire. Nous préparons actuellement la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique à l’horizon 2020, en Chine. qui marquera la clôture des objectifs d’Aichi pour la biodiversité et jettera les bases d’un axe de développement durable axé sur l’environnement après 2020 et visant à offrir de multiples avantages aux populations, à la planète et à notre économie mondiale. Le rapport de l’IPBES servira de base fondamentale pour déterminer où nous en sommes et où nous devons aller en tant que communauté mondiale pour inciter l’humanité à atteindre la vision 2050 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique «Vivre en harmonie avec la nature». Je tiens à exprimer mes remerciements et mes félicitations à la communauté IPBES pour son travail acharné, ses contributions immenses et son partenariat continu. ” Le rapport de l’IPBES servira de base fondamentale pour déterminer où nous en sommes et où nous devons aller en tant que communauté mondiale pour inciter l’humanité à atteindre la vision 2050 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique «Vivre en harmonie avec la nature». Je tiens à exprimer mes remerciements et mes félicitations à la communauté IPBES pour son travail acharné, ses contributions immenses et son partenariat continu. ” Le rapport de l’IPBES servira de base fondamentale pour déterminer où nous en sommes et où nous devons aller en tant que communauté mondiale pour inciter l’humanité à atteindre la vision 2050 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique «Vivre en harmonie avec la nature». Je tiens à exprimer mes remerciements et mes félicitations à la communauté IPBES pour son travail acharné, ses contributions immenses et son partenariat continu. ”
– Cristiana Paşca Palmer , Secrétaire exécutive, Convention sur la diversité biologique
«L’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques ajoute un élément majeur au corpus de preuves de l’importance de la biodiversité dans les efforts pour atteindre l’objectif Faim zéro et atteindre les objectifs de développement durable. Ensemble, les évaluations entreprises par l’IPBES, la FAO, la CDB et d’autres organisations soulignent le besoin urgent d’agir pour mieux conserver et utiliser durablement la biodiversité et l’importance de la collaboration intersectorielle et multidisciplinaire entre les décideurs et les autres parties prenantes à tous les niveaux. ”
– José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture